Mes réalisations
Vous trouverez, ici, les histoires de vie et portraits que j’ai rédigés, mais également des extraits de mes écrits personnels : récits, souvenirs, nouvelles.
Biographies/récits d’instants inoubliables
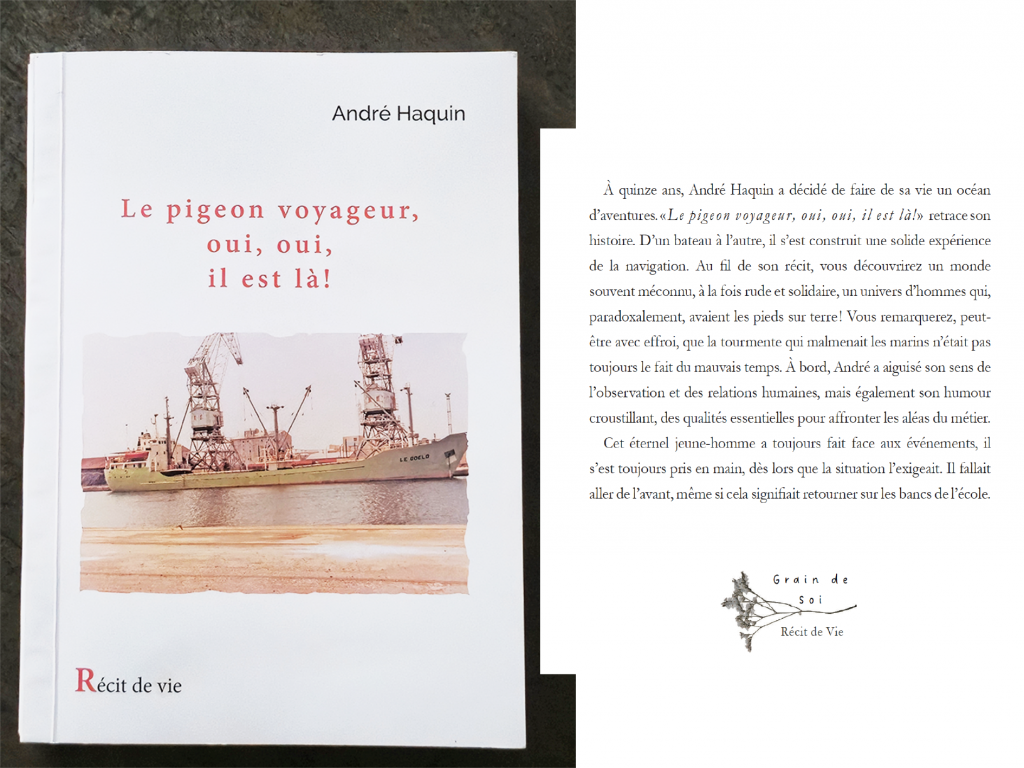
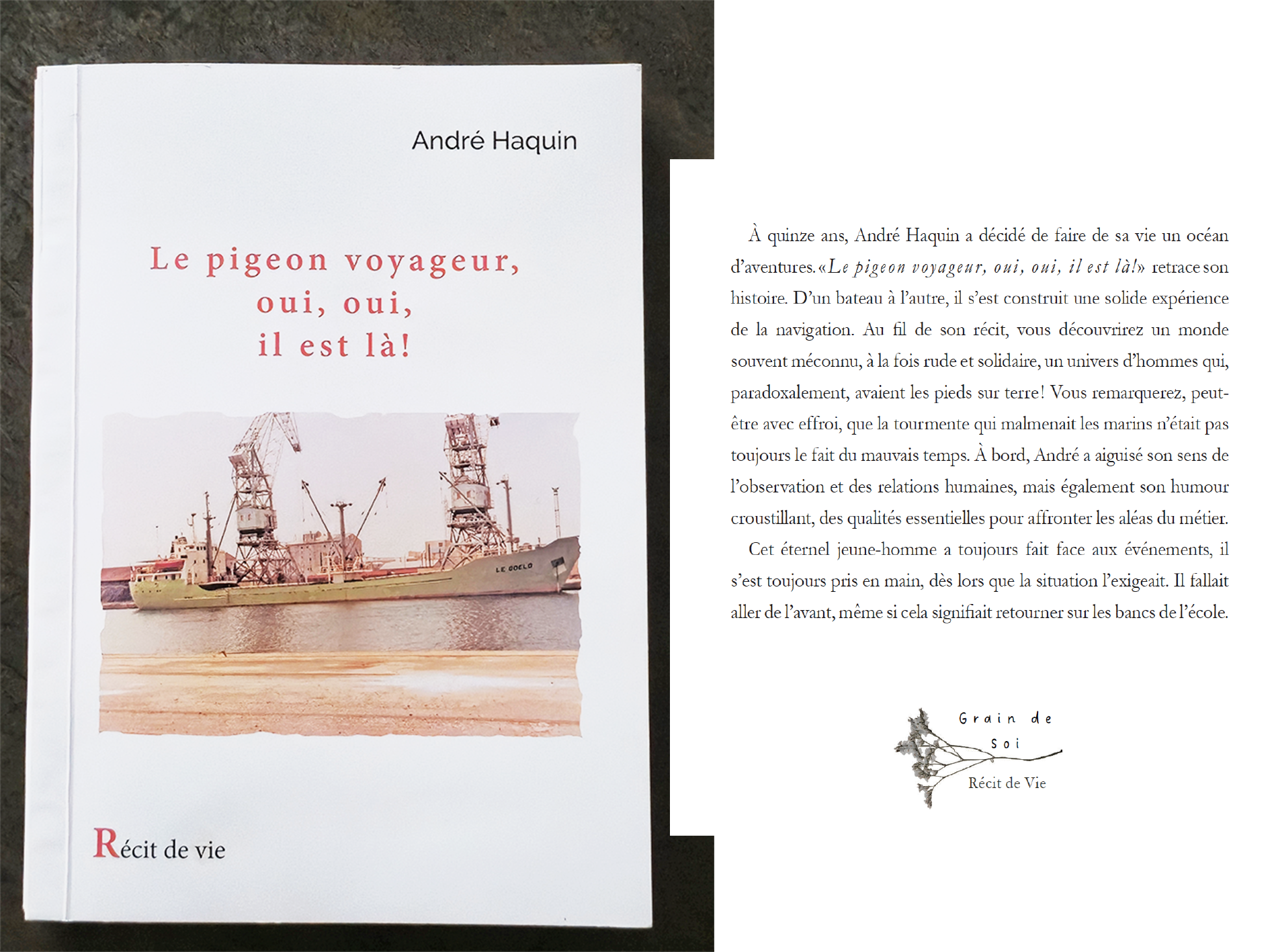
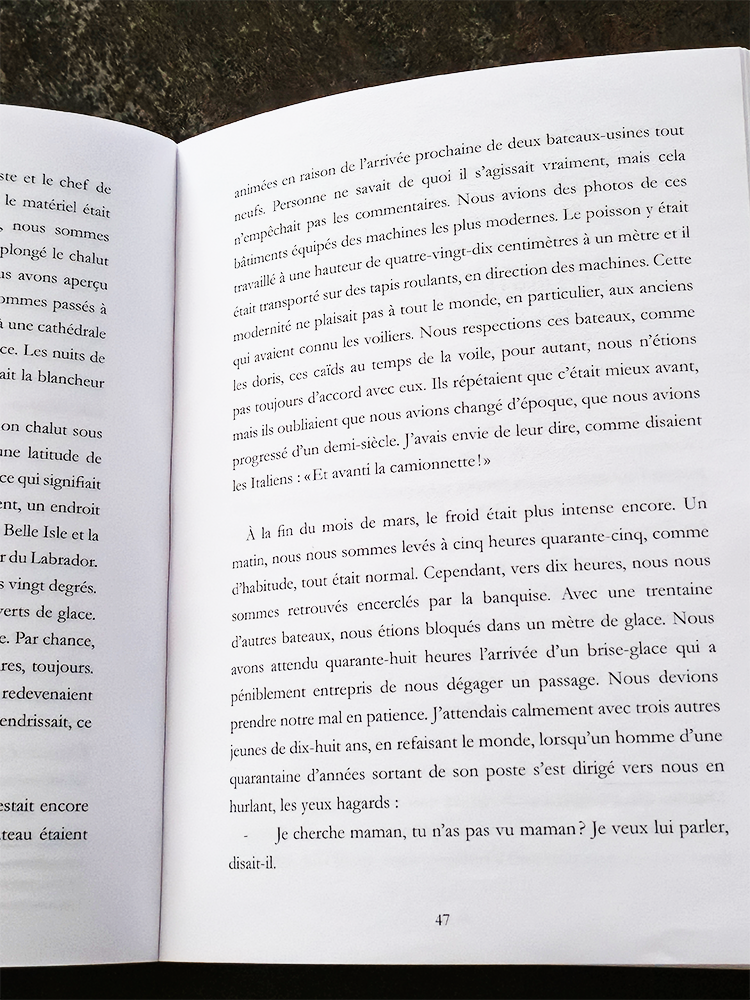
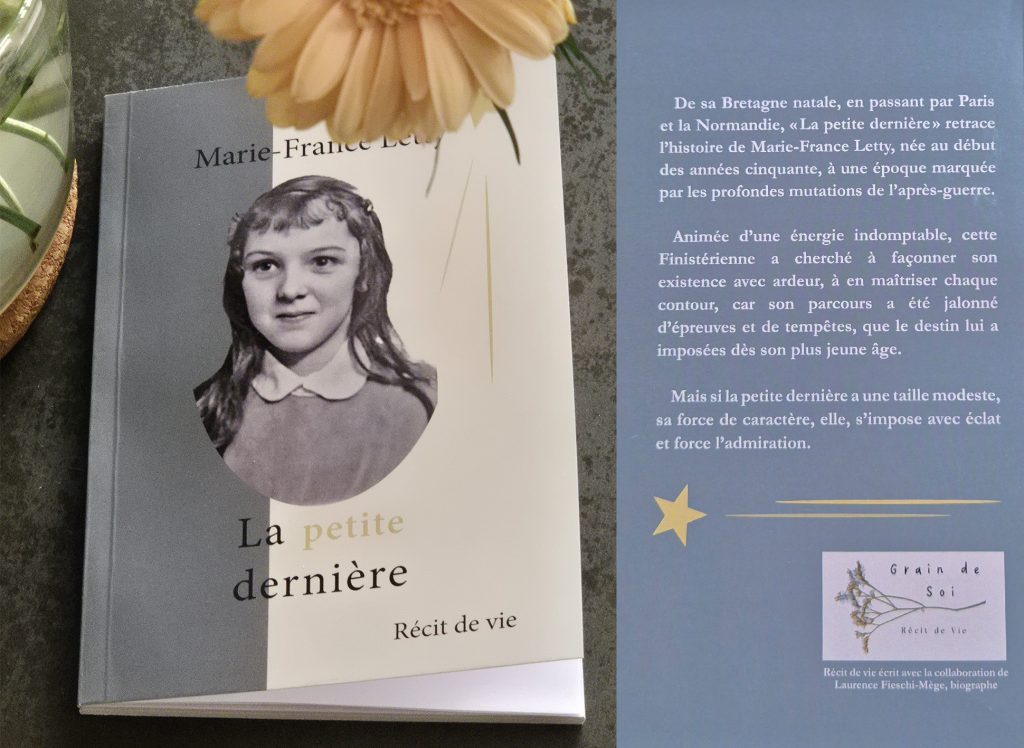

Ne jamais oublier d’où l’on vient et savoir intimement ce que l’on doit à ses parents, deux devises chères à Bernard Noël. J’ai été honorée de la confiance qu’il m’a accordée pour tenir la plume à sa place, ce fut un plaisir de réaliser sa biographie.
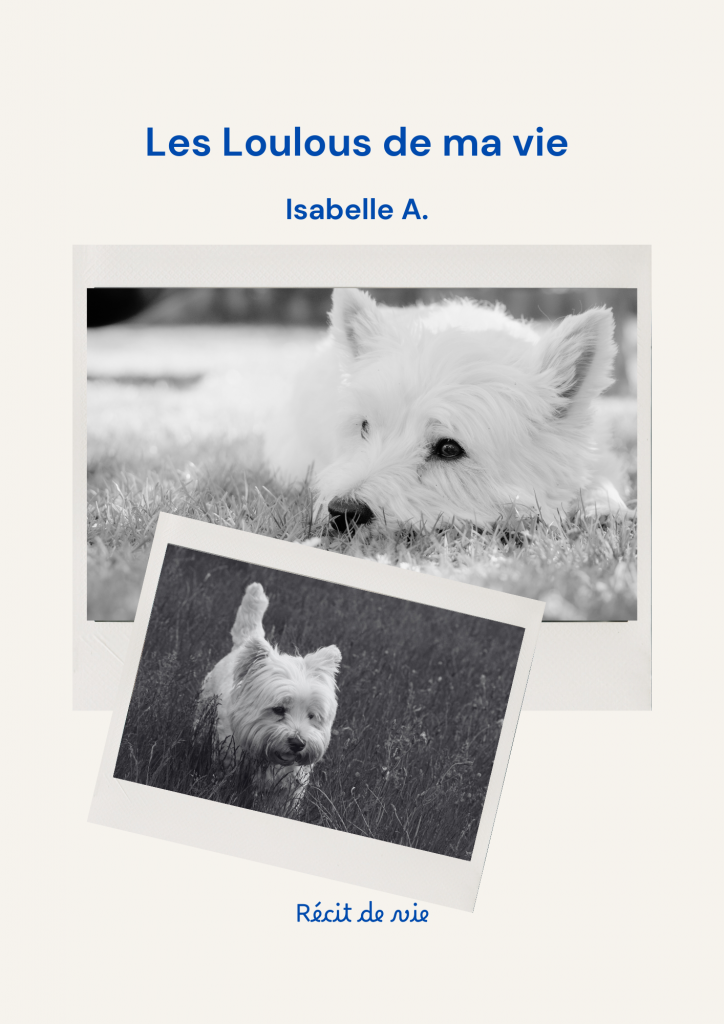
Isabelle m’a confié avec modestie et pudeur, ses liens avec les animaux de sa vie. Une belle histoire.

A travers le récit qu’elle m’a confié, Marie illustre avec délicatesse, la générosité des animaux qui partagent nos vies et l’influence que la relation que nous entretenons avec eux peut avoir sur notre rapport au monde.
Portrait

De tout ce qu’elle a appris de ses parents, de ses expériences personnelles et professionnelles, au fil de ses rencontres et partages, le regard de Nathalie sur la vie s’est aiguisé. Un regard empreint de lucidité et de sagesse, dénué de naïveté, optimiste toujours, même si parfois la vie peut être difficile.
Recueil collectif de souvenirs autour d’un lieu – Avenue Carnot (Extrait)

Cousins et cousines ont partagé leurs souvenirs des moments passés chez leurs grands-parents
Je suis bouche bée. Cette vue ! aussi improbable qu’enchanteresse. Mon frère et ma sœur, intrigués, me rejoignent près de la lucarne. La cour immense, blanche, inaltérable, celle de nos grands-parents lurons, est là, sous nos yeux. Elle présente son visage d’aujourd’hui mais également celui qu’elle offrait il y a plus de cinquante ans. Notre petite sœur ne l’a pas connue mais nous décidons de partir tous les trois sur les traces de son souffle maternel, avenue Carnot. En front de rue, la grille en fer forgé impose son mystère. Elle est noire, opaque, dominante. Elle s’ouvre sur une allée bordée, d’un côté, du pignon de la maison
voisine, de l’autre, d’un mur de pierres. Mémé nous interdit d’y grimper. Il est trop haut. Sous les chaussures, les graviers se frottent, crissent. Ils deviennent projectiles sous ma main d’enfant contrariée. Au bout du chemin, à droite, la cour est là, imprégnée des odeurs familières. Du solex de Pépé aussi. Elle est la toile tissée des pas qui l’ont foulée. L’écho chaleureux des voix qui l’ont effleurée. Théâtre de vie d’une grande famille luronne. Il faut la traverser pour rejoindre les organes du lieu ; la maison, le pigeonnier, le potager et le verger. La demeure est solide, rustique, fraîche. Ses murs larges, protecteurs. Sa façade a résisté aux assauts de l’occupant allemand.
Souvenirs à partager
L’âme du lieu

Souvenir des vacances passées chez ma grand-mère.
Chaque été, nous parcourions près de mille kilomètres pour retrouver notre grand-mère sur la côte d’Azur. Mémé, c’est ainsi que nous l’appelions, habitait dans une résidence des années soixante, perchée là-haut sur la colline qui surplombait la gare de Toulon. Elle y vivait seule, depuis la mort de son mari, Pépé, notre grand-père trop tôt disparu. Ce lieu ne nous est plus accessible aujourd’hui, mais les souvenirs que nous en avons le font revivre indéfiniment. Pour rejoindre Mémé, il fallait gravir quatre étages, sans ascenseur. Elle nous attendait souriante dans l’entrebâillement de sa porte, nous, les Parisiens. Son appartement était un trois pièces, frais, sans prétention. La salle à manger donnait sur un balcon fleuri de géraniums, auquel on accédait par une porte-fenêtre. On dominait alors un parc planté de pins élancés. Mêlés au parfum des fleurs, leurs effluves sublimés par le soleil de juillet, nous parvenaient par les fenêtres ouvertes aux heures fraiches de la journée. Mémé veillait sur son intérieur figé dans le temps, comme une gardienne de musée. Des objets divers semblaient avoir trouvé leur place un jour, pour ne plus jamais en bouger. Sur le bahut, des vases accueillaient des fleurs séchées, égayés par les portraits des petits-enfants posés à leur pied. Des bibelots de facture incertaine, offerts par des cousins de passage, étaient exposés dans la vitrine du buffet. La cuisine, de petite taille, était le domaine réservé de Mémé. On ne devait jamais s’y attarder afin de lui laisser l’espace et l’intimité qu’elle réclamait pour organiser les choses à sa façon. Dès lors, les plats qu’elle y préparait étaient empreints d’un grand mystère. Dans la chambre qu’occupait notre père, enfant, se trouvait un bureau sur lequel étaient posées des étagères qui faisaient office de bibliothèque. Il y avait là des livres anciens, des photos de famille et de vieux objets qui excitaient notre curiosité. Ils portaient une histoire que les mots ne racontaient pas. Et c’était bien ce qui nous animait dans l’appartement de Mémé : découvrir notre histoire par l’intermédiaire de ces natures mortes. Tel un passage secret, elles nous conduisaient tout droit vers le passé familial énigmatique. Nous avions bien connu notre grand-mère, ses qualités, sa poigne, ses goûts, et son souci parfois excessif de ne jamais gâcher. Mais notre grand-père restait pour nous un inconnu. Emporté durant son sommeil, nous avions à peine fait sa connaissance. Nous savions qu’il avait été Berger en Corse, dans les hauteurs de la Castagniccia. Mais la situation économique catastrophique de l’île, dans les années trente, l’avait contraint à partir pour le Continent. Et il n’y avait rien d’autre à savoir, nous disait-on. Nous conservions de lui le souvenir vague d’un homme en retrait et silencieux. Un jour, mon regard s’est posé sur l’un de ses portraits, glissé entre deux livres. C’était un homme mince, de petite taille, au visage allongé, les cheveux coiffés en arrière, de type méditerranéen sans aucun doute. Il regardait l’objectif, la tête haute, mais son esprit était ailleurs. Ses yeux, qu’il avait petits et noirs, trahissaient un soupçon de mélancolie. Sa dernière carte d’identité, soigneusement conservée, était jointe au cliché. Pépé l’avait signée, comme il se doit, mais son paraphe présentait une particularité étonnante. La première lettre du nom qui aurait dû être un « F » n’apparaissait pas, la main ne s’y était pas attardée. A l’inverse, le stylo avait insisté sur la dernière lettre, le « i », sur lequel le point était le résultat d’un appui long et étiré qui lui donnait une forme d’apostrophe. Cette sorte d’interpellation était inattendue car, en Corse, on n’énonce pas la fin des noms. En mettant sciemment l’accent sur la dernière lettre de son nom, mon grand-père avait rompu avec la tradition, comme s’il avait cherché à gommer son identité. Ainsi, le geste de cet homme discret m’est apparu en pleine face comme une évidence. Par cette pièce d’identité, Pépé me soufflait de l’au-delà ce que sa famille avait oublié : l’abnégation dont il avait fait preuve en quittant son île natale. Il avait tu son chagrin engendré par l’exil, mis à distance ses origines pour l’avenir de ses enfants, oublié qu’il avait été Berger au milieu des châtaigniers et renoncé au parfum du maquis. J’ai remis la photo et la carte d’identité à leur place puis j’ai prononcé son nom qui est aussi le mien, distinctement et fièrement. Ce matin-là, j’ai pris conscience que, franchissant le silence entourant son souvenir, Pépé était l’âme du lieu de mes étés. Une âme semblable à ces fleurs emblématiques de l’Ile de beauté, immortelle.
Tadoussac
Souvenir d’un voyage émouvant.

Se rappeler le frisson des nuages
Souvenir romancé d’émotions ressenties dans les hauteurs de l’île de Madère, dans les nuages.

Albane marchait sous le bleu des hauteurs il y a un instant encore et voilà qu’elle ne distingue plus rien autour d’elle. L’air s’est drapé d’un blanc onirique, sans crier gare. Les oiseaux, comme le vent, se sont tus en chœur. Soudain seule, séparée de ses compagnons de marche, elle ralentit ses pas, un brin, émoustillée, suspendue au silence qu’elle scrute. La métamorphose du lieu est si soudaine, quel est ce mystère ? Sur sa peau cuivrée des mois chauds, des myriades de gouttelettes se posent en voile frissonnant.
Elles murmurent à l’oreille de ses craintes superflues qui baissent la garde sur le champ et font place à la volupté. Albane respire, aérienne. Mais, déjà, l’azur regagne du terrain, dispersant les vapeurs laiteuses. Les formes alentour quittent leur manteau opalin : ici, les branches tombantes d’un bosquet, puis l’étang qui trempe ses racines. Là-bas, une vache, puis deux, puis six, allongent leurs pis sur une couche verte et soyeuse. La lumière inonde à nouveau la terre et, avec elle, revient l’activité et le souffle mélodieux de la montagne.
Le Chien
Pour ne pas oublier les moments passés avec lui et les émotions qui leur sont associées.
Tu es parti il y a plus d’un an, par une nuit glacée. Je ne pouvais plus te regarder de ma place d’égoïste. Me détourner de la seule issue raisonnable, celle de te quitter, avait assez duré. Tu n’étais plus vraiment là, plus rien ne t’intéressait, même manger était devenu une épreuve, seul tu n’y arrivais plus. Ta tête était devenue trop lourde à porter. Ta grande force, si remarquable jadis, t’avait quitté. Tes derniers regards me signifiaient, je crois, qu’il était temps de se dire au revoir, de fermer les yeux et de se souvenir.

Je te surnommais affectueusement « Le Chien ». J’adorais t’appeler ainsi. L’article « le » faisait toute la différence, il certifiait la valeur que tu avais à mes yeux. Et l’usage du mot « chien », le respect que je portais à ta race. Je me souviens de toi, chaque jour, même si je pleure ton absence encore trop présente. Ta chaleur, ta vitalité, ta fidélité, ta bonne humeur. Tu n’as jamais, jamais, manifesté d’agressivité envers quiconque, même en situation inconfortable chez le vétérinaire.
Ta seule préoccupation était d’être près de nous, de jouer avec nous et de nous protéger. Cette façon que tu avais de te glisser entre un chien et moi, au cas où. Personne ne te l’avait pas enseignée, c’était inné. J’étais fière de toi, ton attention canine me disait l’importance que tu m’accordais. J’espère, en retour, que tu as pu sentir à quel point ta présence à mes côtés était si douce. Je veux me souvenir de ces moments de grâce où tu te laissais aller, couché sur le dos. Je plaçais ma main, comme ça, sur ton ventre, pour sentir ta chaleur et te donner la mienne. Tu prenais une grande inspiration et te détendais encore un peu plus. J’en retirais un sentiment de bien-être et de communion. Et tes yeux brillants lorsque, sans te prévenir, je prenais la balle de tennis. Tu savais qu’un temps de jeu s’ouvrait alors, que seul ton cœur un peu capricieux t’obligeait à écourter. Tu adaptais tes gestes aux préférences de chacun. Avec moi, tes attitudes étaient câlines et paisibles. Aux enfants, tu réservais des corps à corps haletants. Avec le père de famille, je crois que tu endossais un rôle d’aîné, sérieux, responsable, bien qu’un peu intimidé. Lorsque je jardinais, toi couché à quelques pattes de mes bottes, sans jamais te lasser de mes mouvements décousus qui t’obligeaient à te relever sans cesse. Passer des heures dans le jardin, les mains dans la terre, en sentant ta présence tranquille à mes côtés, constituaient des bulles de bonheur dans ma vie parfois un peu trop chargée. Et ce geste que je t’ai vu faire lorsque tu étais jeune, répétant celui que je venais d’accomplir pour dégager la terre qui bouchait la grille d’accès au compteur d’eau. Tu étais un observateur discret, tes yeux enfouis sous un halo d’encre noire. Pensant à l’avenir, je m’étais dit : aïe, ça va être compliqué ! mais j’étais fière. Le Chien ! tu as passé la porte de notre maison un beau jour d’été, de ta déambulation maladroite de chiot, puis tu es parti un soir de janvier, froid et douloureux. Oui, indéniablement, notre histoire s’est avérée trop courte. Fort heureusement, nous avons vécu ensemble des instants heureux, complices, joyeux, qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Le Chien ! tu garderas indéfiniment une place de choix dans mes souvenirs où je te vois, couché, aux pieds de ceux parmi les miens qui sont partis, eux aussi, trop vite.
Le Chat, mon ami
Se souvenir de l’histoire vécue avec lui, de sa douceur.

Je ne sais pas combien de photos j’ai prises de lui. Je ne me lassais pas de le regarder. Il était tellement beau, le plus beau ! Un magnifique chat « de gouttière ». Et d’une douceur… Il est arrivé un jour dans mon jardin pour ne plus jamais en partir. Pourtant, il y avait deux chiens dans ce jardin, dont un qui chassait fermement les intrus ! Mais, avec intelligence et persévérance, il est entré dans ma vie et dans celle de ma famille. Il était maigre et l’une de ses pattes était blessée. Il était sale et puait. Il s’est d’abord blotti au fond de la niche du chien le plus difficile à convaincre ! Je l’en ai délogé avec l’aide de Carole, ma voisine, afin de l’identifier de plus près et de l’inviter à quitter le jardin. Puis, je l’ai retrouvé sur le rebord de la fenêtre du salon. Nous n’avions pas décidé de prendre un nouveau chat, mais celui-ci semblait déterminé. Il s’est ensuite glissé sous un meuble de la cuisine. Il avait peur et se déplaçait avec prudence. Quelques croquettes déposées par terre, comme les petits cailloux du Petit Poucet et nous avons vu apparaître le bout d’une patte affamée. Lentement, cette patte s’est déployée pour attraper, toujours plus loin, la ligne de croquettes. Les griffes coupées nous ont indiqué qu’il était issu d’un autre foyer. Nous sommes allés poser des affiches dans divers lieux publics, avec sa photo et notre numéro de téléphone, mais personne ne l’a réclamé. Prendre une décision s’imposait, nous avons choisi de le garder auprès de nous, de le nourrir et lui apporter les soins nécessaires, mais sans trop en faire. Cela a commencé par une visite chez le vétérinaire, notamment pour soigner sa patte. C’était il y a 13 ans. Avec patience et douceur, je suis devenue sa bouée, son amie, celle qui se levait aux premiers miaulements pour lui ouvrir la porte (30 fois par jour !) et remplir sa gamelle (tout de suite !). La confiance entre nous s’est installée au fil des jours. Je ne saurai jamais ce qu’il avait vécu avant d’arriver chez nous, mais cela ne ressemblait pas à du bonheur. Je l’ai laissé venir vers moi et nous avons appris à nous connaître. Une seule caresse, toute petite, sur la tête, puis deux, …puis cent. Le prendre dans mes bras a demandé du temps. Il est devenu un chat « pot de colle », répondant au nom de Cacahuète. Il a pris du poids, un peu trop peut-être ! Toujours là à mon réveil et le soir devant le portail, lorsque je rentrais du travail. Quand il prenait place sur mes genoux pour réclamer mon attention, je ne bougeais plus, je crois même que je ralentissais ma respiration. Je voulais que ces moments ne s’arrêtent jamais. Au printemps, je profitais des doux rayons de soleil matinaux, assise sur le bois de la terrasse, avec lui à mes côtés. J’admirais les frémissements de l’eau du petit bassin et des feuilles sous la brise. C’était ça que je préférais partager avec lui et je pense que lui aussi. Quand je le serrais dans mes bras, il accompagnait mon geste par une pression de tout son corps. Je pouvais alors sentir sa chaleur et entendre son vibrant ronronnement. Comme lui, je fermais les yeux pour ressentir pleinement l’apaisement qui s’installait en moi. C’était miraculeux ! Quelques secondes suffisaient à balayer toutes mes contrariétés de la journée. J’ose espérer qu’il en était de même pour lui. Il n’a jamais cessé de fuir toutes personnes étrangères qui passaient à la maison. Seules les plus régulières et délicates sont parvenues à le rassurer. Les belles histoires ont une fin. On le sait dés leur commencement. Pourtant, on les vit toujours comme si on l’ignorait. Il nous a quitté il y a à peine une semaine. Je le pleure encore. Sa présence et notre complicité me manquent. Mais l’exprimer adoucit un peu ma peine. Je ne veux pas oublier ce qui précisément me liait à lui. Voilà c’est écrit !
Nouvelles
Se souvenir de l’essentiel (extrait)
« Aujourd’hui, le boss s’est absenté pour un rendez-vous chez un client. Coraline qui vient d’ouvrir les courriers, m’apporte celui d’une association. Elle me fait remarquer qu’il est question des problèmes de trésorerie que la structure rencontre. L’association accompagne des enfants en grande difficulté et ses financeurs historiques ont décidé de diminuer drastiquement leurs subventions. Coraline s’interrompt et penche la tête sur le côté en se mordant les lèvres. Elle blêmit. Je distingue les efforts qu’elle fournit pour contenir son émotion. Mais soudain, sa colère éclate comme une onde de choc :
-Je ne comprends pas ça, comment peuvent-ils décider de délaisser cette association ? Elle est pourtant essentielle ! Comment va-t-elle faire pour poursuivre ses actions ? Et les enfants ?
Que vont-ils devenir ?

Coraline ne décolère pas et fustige les institutions qu’elle juge criminelles. Elle passe en revue les scandales similaires dont la presse s’est faite l’écho. Elle semble particulièrement affectée. Surpris, je découvre un pan de sa personnalité jusque-là inexprimé. Je trouve qu’elle exagère un peu, les associations ne sont pas les seules à s’occuper d’enfants en difficulté et il doit bien y avoir d’autres moyens d’assurer leur existence. Mais, d’un autre côté, la voir ainsi dans cet état d’exaspération me fascine, je ne sais pas pourquoi !
J’ai envie de lui sourire mais ne le ferai pas, elle pourrait mal l’interpréter. Alors, je me contente d’écouter sa longue démonstration, en opinant du chef à intervalle régulier. Contre toute attente, elle se tait soudainement, prend une grande inspiration et retourne dans son bureau. Je la suis du regard, interloqué. De mon siège, je peux l’observer discrètement, la colère se lit encore sur son visage. Je tente de replonger dans mes chiffres mais j’ai du mal à me concentrer. Je lutte pour retrouver mon calme, en vain. »
L’odeur de l’humus (extrait)

Cela fait vingt minutes que nous trottons. Je suis de plus en plus perplexe. Mon frère bifurque subitement vers la droite, s’enfonce sous les feuillus, à la recherche de … mais de quoi au juste ? je l’ignore. Il fait humide par ici, la mousse forme un tapis spongieux sous nos pieds. Je constate qu’il en existe différentes espèces. Il règne un silence monacal à peine éraflé du vol des oiseaux. L’odeur de l’humus emplit nos narines. Romain a ralenti sa course, ses pas se font plus aériens. Ils laissent ses mains pendre le long de son corps et effleurer les fougères sur son passage. Il examine la futaie, se penche quelque fois sur un tronc, tâte son écorce, porte ses doigts parfumés de sève à son nez. Il enduit ses joues du liquide collant. Son geste me dégoûte un peu. Romain s’arrête à la hauteur d’un arbre immense. Son tronc robuste a la largeur d’un pilier de cathédrale. Des cœurs y ont été gravés par des amoureux transis. Sa ramure dense, équilibrée, déploie son halo vert argenté sans contrainte. C’est peut-être le chêne doyen de la forêt. J’ai la sensation étrange qu’il nous attendait. Mon frère s’assied en tailleur à son pied. Il ferme les yeux, semblant méditer. Quelle drôle d’idée, il doit être gelé sur ce sol trempé. Je m’oblige à rester à distance pour ne pas le gêner. Les minutes passent, je m’impatiente mais j’aperçois dans la pénombre deux larmes qui brillent au coin de ses yeux. Cela me déstabilise mais je me tais. Le soleil s’infiltre à travers la canopée. Il éclaire agréablement ce lieu que je trouvais obscur. Ses rais animent les feuillages. Le corps arrimé au sol, mon frère respire maintenant à plein nez. Il inspire comme un noyé qui reprend vie, il avale les émanations vivifiantes de la terre. Il se transforme sous mes yeux. Son bonheur est évident, simple, sans artifice. Il remplit l’espace. Je suis fascinée. Une douce chaleur me prend par les épaules. La forêt chante. Le grand arbre se fait maestro. Sous son houppier, un frémissement m’attrape les chevilles. Les insectes bourdonnent des notes subtiles. Une lueur enveloppe Romain dans un dégradé de rouge velouté. Je reste bouche bée. Romain ouvre les yeux et me sourit sans retenue. Son visage ne marque plus aucune crispation. Il s’étire et ramasse du terreau à pleines mains qu’il hume avec délectation. J’ai pensé un instant qu’il allait le goûter. Il se lève sans considérer son pantalon mouillé, quelle importance ! Nous partons en demeurant concentrés pour qu’aucun atome d’air inhalé ici ne s’échappe de nos poumons, que chaque seconde écoulée reste gravée, dans le souvenir. Je perçois maintenant ce qui ne pouvait attendre. Je comprends le choix de Romain. Où d’autres qu’en forêt aurait-il pu retrouver l’ineffable beauté ?